Information
A propos Al-Sabil
Numéros en texte
intégral
Numéro 13
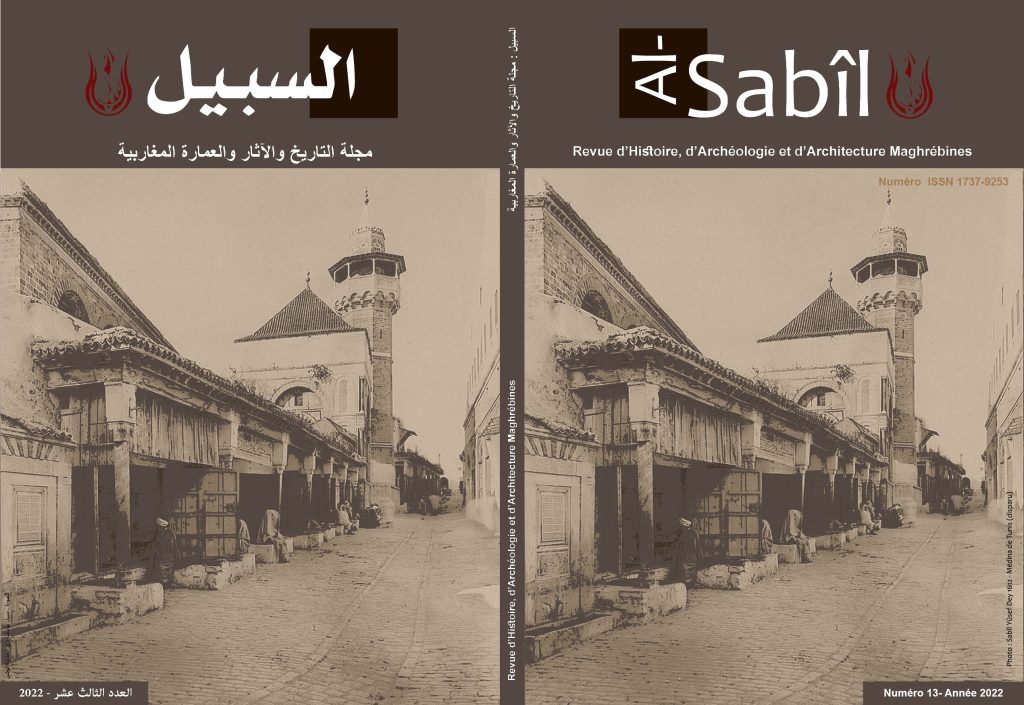
Préface
Saloua Ferjani
La place et la signification du végétal dans la Médina de Tunis. Une dimension cachée
Imène Zaâfrane Zhioua
Écologie urbaine dans la ville de Chefchaouen
Leila Harabi
13| 2022
Écologie urbaine dans la ville de Chefchaouen.
Leila Harabi
Table des matieres
Introduction
1. Contexte naturel de la ville de Chefchaouen
2. Gestion et distribution de l’eau et éléments urbains corrélés
3. Jardins, villégiatures Espaces verts périurbains; Agrosystèmes
Conclusion
Résumé
La relation ville-nature est au cœur des préoccupations actuelles, particulièrement suite à la crise de l’épidémie du coronavirus. Un large consensus, aux quatre coins du monde, requière l’incorporation de la nature dans la ville. Cela consiste certes à préserver les lieux naturels urbains et périurbains dans les cités historiques et concevoir de futures cités écologiques. Chefchaouen, la ville rifaine, disposant d’un patrimoine culturel et d’un potentiel naturel d’exception ne cesse de défier des enjeux environnementaux.
Maints outils, méthodes, et instruments législatifs sont mis en œuvre par divers acteurs afin de préserver cette richesse naturelle, et d’installer un nouveau concept de ville résiliente et écologique. Les méthodes de développement durable exigent alors de ponctuer l’espace urbain de la ville de zones vertes, de villégiatures, de jardins et de parcs aménagés, mais également de protéger la biosphère qui la longe.
Mots clés
Chefchaouen, ville durable, écologie urbaine, résilience, nature.
Abstract
The city-nature relationship is at the heart of current concerns, particularly following the crisis of the coronavirus epidemic. A broad consensus, all over the world, requires the incorporation of nature into the city. This certainly consists in preserving natural urban and peri-urban places in historic cities and designing future ecological cities. Chefchaouen, the Rifan city, with an exceptional cultural heritage and natural potential, continues to challenge environmental issues.
Many tools, methods, and legislative instruments are implemented by various actors in order to preserve this natural wealth, and to install a new concept of resilient and ecological city. Sustainable development methods therefore require punctuating the city's urban space with green areas, resorts, gardens and landscaped parks, but also protecting the biosphere that runs along it.
Keywords
Chefchaouen, sustainable city, urban ecology, resilience, nature.
الملخّص
تعتبر العلاقة بين المدينة والطبيعة من ابز الاهتمامات الحالية خاصة إثر ظهور أزمة وباء كورونا، مما جعل الكل يجمع على ضرورة دمج الطبيعة في المدينة. ويتمثل ذلك في الحفاظ على الأماكن الحضرية وشبه الحضرية الطبيعية في المدن التاريخية وتصميم مدن مستقبلية مستدامة. في هدا المضمار، لا تزال شفشاون، مدينة الريف بشمال المغرب، تواجه تحديات بيئية عديدة على تمتعها بتراث ثقافي استثنائي وثروات طبيعية متفردة.
ويتم الاعتماد على العديد من الأساليب والأدوات التشريعية من قبل مختلف الجهات الفاعلة من أجل الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية وتثبيت مفهوم جديد للمدينة الحضرية المستدامة. ويتطلب ترسيخ هذه المبادئ الرجوع الى أساليب التنمية البيئية منها احتواء المساحة الحضرية للمدينة على مناطق خضراء ومنتجعات وحدائق ومتنزهات ذات مناظر طبيعية مهيأة، كما تتطلب كذلك حماية المحيط الحيوي المحاذي له.
الكلمات المفاتيح
شفشاون، المدينة المستدامة، البيئة الحضرية، المدينة الصامدة، الطبيعة.
Pour citer cet article
Leila Harabi, « Écologie urbaine dans la ville de Chefchaouen », Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture
Maghrébines [En ligne], n°13, Année 2022.
URL : https://al-sabil.tn/?p=6744
Texte integral
L’exponentielle domination humaine de son environnement naturel demande de déterminer l’alliance ville/nature et de redéfinir sa forme. Les bilans d’impacts divulguent un rapport conflictuel et alertant entre l’Homme et la nature, exigeant de concevoir désormais de futures cités écologiques. Ce nouvel aspect urbain annonce l’ampleur de ce souci d’actualité. De prime abord, le développement de la sensibilité écologique des populations est un gage pour protéger l’environnement urbain d’aujourd’hui en péril.
Le concept d’«écologie urbaine »1 appelle à l’application de méthodes de développement durable imposées, et ce en favorisant la présence de la nature en ville indépendamment de sa typologie urbaine. Il s’agit alors d’entretenir la relation Homme/Nature afin de construire des villes durables ponctuées d’espaces verts, de villégiatures, de jardins et de parcs aménagés. Cet aspect de la ville a amplement soulagé l’humanité lors de la propagation de la pandémie du Covid-19, faisant d’elle une échappatoire, en rappelant la nécessité de s’adresser à la nature lors des crises sanitaires, et l’idée que l’Homme est étroitement lié à son écosystème.
Dans les cités historiques, la mise en valeur du patrimoine naturel indissociable du patrimoine culturel, souvent de proximité, agit en faveur du développement de l’alliance ville/nature. Ce fort potentiel séculaire, préservé depuis des millénaires avec des méthodes ancestrales avait fait des cités antiques et médiévales des alliées de la nature. De toute évidence, d’immenses liens se tissaient alors entre les sociétés anciennes et les représentations de l’environnement ; un concept de durabilité qualifie ces cités souvent installées sur le bord d’un fleuve, sur la lisière d’une forêt ou d’une plaine, sur le flanc d’une montagne, au bord d’une mer ou même autour d’un généreux puits.
La pittoresque Chefchaouen, petite ville de montagne marocaine, en est un bon exemple. Elle apparait au cœur d’un environnement naturel singulier, doté d’un riche patrimoine naturel et culturel. Elle surgit du pays des « jbala-s », territoire d’un patrimoine naturel d’exception et d’une biosphère riche et diversifiée. La ville est un modèle d’une réconciliation d’une communauté avec un environnement naturel à relief et climat durs et inhospitalier, mais si généreux. C’est un archétype d’occupation et d’organisation territoriale arrangée avec la nature. Toutefois, en dépit de son enclavement dans les dédales montagneux de la région, elle n’a pas échappé aux enjeux liés à l’environnement naturel. Son réservoir de biodiversité exige des différents acteurs et aménageurs le recours à des stratégies particulières afin de conserver son patrimoine urbain et périurbain, et de mettre en valeur une écologie urbaine dans la cité. Comment a pu-t-elle maintenir son aspect de ville verte, résiliente et durable, défiant maints aléas et enjeux environnementaux ? El quels sont alors les instruments législatifs et les outils règlementaires qui ont été mis en vigueur afin de préserver ce patrimoine naturel et de le développer ?
1. Contexte naturel de la ville de Chefchaouen
1.1. Localisation
La ville de Chefchaouen ou Chaouen, chef-lieu de la province du même nom, est située en plein cœur du pays Jbala, nichée dans des sommets pouvant dépasser les 2000 mètres d’altitude du Rif occidental au Nord-Ouest du Maroc et abritant 42 786 habitants en 20142. Cependant, quelques 50 Km la séparent des côtes méditerranéennes. Son enclavement à une altitude de 600 mètres en plein site rifain ne peut être le fruit du hasard. Bien au contraire, il découle d’un choix stratégique de ses fondateurs, le saint Alami Moulay Ali Ben Rachid qui, accompagné de ses soldats andalous, conçut pendant la deuxième moitié du XVe siècle le premier noyau de la cité castrum visant à inhiber l’invasion des ibères3. Depuis sa fondation en 1471, les autochtones « jbala-s » ont accueilli les andalous, puis les morisques et les juifs séfarades qui ont quitté l’Andalousie espagnole au temps de la Reconquista, développant ainsi au fil des années, une culture méditerranéenne typique emblématique de la région rifaine. C’est« l’unique médina de situation intramontagnarde. Toutes les autres villes traditionnelles sont soit sur la côte, soit à l’intérieur, en plaine ou en bordure de plateaux, ou bien dans une zone de contact entre montagne et bas-pays»4.
La médina, inlassablement occupée depuis sa fondation, développe un tissu urbain compact séculaire et dense, irrigué par un réseau de voiries piétonnes en sa majorité. S’adaptant savamment au relief accidenté du site, et aux techniques constructives qui respectent les conditions climatiques, Chefchaouen est un modèle de ville durable à faible impact sur l’environnement. Elle est en outre, adroitement équipée d’habitations et de services, joignant l’aspect social et économique de la médina.

Découvrant cette ville, Charles De Foucauld, voyageur qui l’avait visitée en 1883, l’avait décrite en ces termes : «…la ville, enfoncée dans un repli de la montagne, ne se découvre qu’au dernier moment… on est parvenu à la muraille rocheuse qui la couronne, on en longe péniblement le pied au milieu d’un dédale d’énormes blocs de granite où se creusent de profondes cavernes. Tout à coup ce labyrinthe cesse, la roche fait un angle : à cent mètres de là, d’une part adossée à des montagnes à pic, de l’autre bordée de jardins toujours verts, apparait la ville… l’aspect en était féérique, avec son vieux donjon, à tournure féodale, ses maisons couvertes de tuiles, ses ruisseaux qui serpentent de toutes parts; on se serait cru bien plutôt en face de quelques bourgs paisibles des bords du Rhin que d’une des villes fanatiques du Rif …»6.
1.2. Contexte géographique de la province de Chefchaouen
La position de la ville sur la dorsale calcaire, relief majeur du Rif Occidental du Nord marocain, complique son accès et rend son franchissement difficile. La topographie du lieu, caractérisée par une alternance de crêtes et de vallées, en est la cause. De son côté Sud-Ouest, le site de la ville s’appuie sur le flanc de Djbel Tissouka de 2050 mètres d’altitude. Le climat de Chefchaouen est de type méditerranéen, caractérisé par la présence de deux saisons entièrement disparates : un été sec et chaud s’étendant sur des mois, et un hiver froid et pluvieux. Pluviosité abondante et chutes de neige y sont très fréquentes pendant la saison hibernale. Sa situation centrale entre deux influences marines, atlantique et méditerranéenne, lui procure une douceur du climat7.
1.3. Biodiversité / agro diversité
Située sur un territoire isolé, Chefchaouen est connue pour posséder « la plus grande forêt de conifères du Maroc, parmi les plus importantes zones d’intérêt biologique »8. La province de Chefchaouen, couvrant une superficie de 3310,36 km² est un territoire riche en forêts de chêne-liège. Elle contient l’une des grandes sapinières du Maroc. Ce site naturel à intérêt biologique est un parc naturel classé. Outre sa diversité floristique, il est abondamment pourvu en ressources hydrauliques. De célèbres sources jaillissent en plusieurs points de la province et alimentent la grande rivière « Oued Laou » qui la traverse; nous en citons : Ras-El-Maa, Tissemlan, Cherafat d’Akchour et Magoun. Les rivières, les cascades et les cours d’eau superficiels et souterrains parachèvent le répertoire des riches ressources hydrauliques de la région. Ce paysage naturel mixte géologiquement composé de grottes, de vallées, de formations rocheuses et d’un relief très accidenté spécifie la zone et la dote d’un fort potentiel touristique. Le Parc des Talassemtane occupe une bonne partie de la province ; le site abrite un nombre d’espèces végétales et animales remarquables. Le cèdre et le pin sont les principales espèces floriques de la région.
2. Gestion et distribution de l’eau et éléments urbains corrélés
Chefchaouen est une « ville d’eau » ; claire, abondante et vive issue des montagnes, cette ressource naturelle a incité les fondateurs andalous à s’y établir. La ville doit sa fondation à cet élément naturel surgissant de la source naturelle de Ras-El-Maa, dont le nom signifie l’origine ou la naissance de l’eau, considérée comme la pierre d’angle de son établissement. En effet, le point d’altitude de cette source a été déterminant lors du choix du site de fondation de la ville. La région de Chefchaouen devient alors un des principaux châteaux d’eau du Maroc. L’eau de la source Ras-El-Maa était distribuée selon une technique de partage afin de satisfaire les demandes de toutes natures. Afin de bien gérer les eaux abondantes de cette source et bien d’autres moins célèbres, les fondateurs ont installé des moulins à eau ponctuant les cours de Ras-El-Maa et des fontaines dispersées dans les quartiers de la ville. En outre, des lavoirs publics, des espaces verts, des jardins et des potagers ont été établis en aval de la source.
2.1. Les fontaines
Nul ne peut nier qu’elles sont l’un des emblèmes de la ville. Certaines d’entre elles, qui sont originelles et datent des premiers siècles de la fondation de la ville, gardent encore leur première forme et sont toujours fonctionnelles. Associées à la topographie à forte déclivité et aux sources abondantes, elles constituaient les principaux points d'approvisionnement en eau potable des quartiers. A maintes occasions, elles ont fait l’objet de restauration à l’instar des autres monuments historiques de la ville. Les fontaines publiques sillonnent les places et les rues de la cité et meublent les murs des places et placettes recevant une décoration développée et d’une grande minutie.

Source : photos de l’auteure, 2017.
2.2. Les moulins à eau
Ce sont les eaux abondantes à fort courant qui ont généré ces systèmes hydrauliques ingénieux. Jonchant les deux rives de la source, Ras-El-Maa alimentait les moulins en énergie grâce à la forte déclivité du site. La construction de cet élément générique de l’architecture urbaine est attribuée aux premiers andalous qui les ont conçus dès la fondation de la ville. Elles ont eu la forme de petites constructions situées sur le cours des fossés, équipées d'une roue en bois à axe vertical entraînée par la force de l'eau descendant le canal9. Appelés également « Naûra-s », « Tahuna-s », « Rha-s » », ces moulins fonctionnaient selon le même principe adopté dans les villes du Maghreb : les moulins actionnés à l’eau sont juxtaposés à un réservoir de chargement. Chutant sous une forte pression, l'eau entraîne une roue métallique équipée de lames, à travers une épingle en bois, transmet le mouvement à la meule en pierre placée horizontalement au-dessus d’un autre broyeur fixe. Les grains sont versés dans un entonnoir en bois qui surmonte les roues de pierre ; la farine est ensuite collectée dans un récipient sous-jacent10. Outre les moulins à grains, nous mentionnons également les moulins à huile dits communément « Rha-el-zit » fonctionnant selon le même dispositif. Actuellement, ces moulins à eau cèdent la place aux nouvelles infrastructures équipant le quartier environnant obéissant à un aménagement urbain prônant l’attraction touristique.
2.3. Les lavoirs
Ce type particulier d’équipement urbain est spécifique à la ville marocaine et ne se trouve nulle part dans le reste du Maghreb. Les lavoirs de Chefchaouen fonctionnent comme des buanderies qui s’établissent à la périphérie de la médina, sur les berges du cours d’eau, au point prépondérant de la cascade de Ras-El-Maa. C’est là que se déroule le lavage des vêtements d’une manière traditionnelle. Le lieu n’est fréquenté que par les femmes de la ville venant profiter des eaux propres de ce tronçon du ruisseau11. Elles se rassemblent périodiquement et accomplissent leur tâche de lavage dans une ambiance réjouissante. Ces espaces sont des lieux privilégiés de rencontres, d’échanges, de rires, de retrouvailles et d’histoires sur le cours de Ras-El-Maa.
Ainsi, l’eau a-t-il amplement contribué au façonnage du paysage urbain de Chefchaouen. La source naturelle Ras-El-Maa a généré des repères urbains marquants qui ont traversé la ville. Fontaines, moulins et lavoirs publics sont ainsi des équipements urbains remplissant des rôles économiques et sociaux très importants.
3. Jardins, villégiatures Espaces verts périurbains; Agrosystèmes
La ville conserve encore de nombreux vides urbains intramuros occupés par des vergers, des jardins, des bosquets, et des espaces verts aménagés, particulièrement sur les terrains à forte déclivité, ou sur les berges de la source de Ras-El-Maa. La toponymie de certains champs est encore associée aux familles originaires de la ville12.
3.1. Espaces verts et jardins aménagés
Outre les jardins privés domestiques, souvent étroits et de superficie réduite, de vastes taches vertes se dispersent à l’intérieur des murailles en vestiges de Chefchaouen.
3.1.1. Jardins privés domestiques de Chefchaouen.
La demeure chaounie possédait souvent un jardin potager irrigué dit « gharsa ». Celui-ci contenait des vignes, des orangers, des figuiers, des oliviers et notamment les mûriers depuis que la culture de la soie a été introduite au Maroc par les Andalous et que les échanges d’articles en soie étaient très actifs entre Tétouan et Fès13. Les jardins privés dans les demeures sont désormais menacés par les extensions anarchiques. Le morcellement foncier conséquent au partage entre les héritiers ne cesse d’aggraver ce phénomène, atteignant en outre les patios et les espaces plantés dans les jardins domestiques.
3.1.2. Jardin intérieur de la Casbah
Ce vaste jardin agrémente l’intérieur de la casbah de Chefchaouen, siège du pouvoir du chérif Alami Moulay Ali Ben Rached, qui l’avait construite à l’aube de la fondation de ville, dans le but de fortifier ce nouveau camp militaire du Rif. S’étalant sur 1800m2 environ, ce jardin se déploie sur toute l’aire découverte à l’intérieur, occupant environ la moitié de sa superficie totale. Cet espace découvert et planté, avoisinant la résidence princière et la zone palatiale de la casbah, a été conçu à l'origine vers les XVe et XVIe siècles comme un terrain de parade pour les militaires. Il a ultérieurement muté en un espace de détente, de distraction et de récréation lorsque des murailles fermées percées de portes urbaines ont cerné la ville. Ce verger-jardin assurait alors la distraction et le bien-être de la famille seigneuriale résidant dans « la Maison du Makhzen » construite dans l’espace intramuros de la casbah vers le XVIIIe siècle14. Le jardin est traversé d’étroites allées croisées perpendiculairement, générant ainsi des aires carrées plantées de végétation à laquelle s’ajoutent des points d’eau dispersés. Une fontaine occupe le centre de l’axe principal de la cour. Cet aménagement a été conçu selon un plan typique arabo-andalou rappelant les potagers des résidences des sultans nasrides situées non loin de l’Alhambra, disposés en terrasses et aménagés avec des carreaux plantés et d’allées toujours associés à l’élément eau15. Le jardin intérieur de la Casbah entre autres places et jardins publics de la ville, a fait l’objet d’études urbaines en 1944, faisant partie des détails du plan d’aménagement urbain de la ville16.



Source : photos de l’auteure, 2017.
3.1.3. Jardin extérieur de la Casbah
Ce jardin est aménagé à l’extérieur de la casbah, au pied du rempart dans son côté sud. Son agencement a été lié à celui des jardins intérieurs, bien qu'ils soient séparés par des murailles. Sa configuration actuelle est assez récente. Elle remonte au début du XXe siècle, suite à l’intervention des colons espagnols qui l’ont mis en œuvre afin d’avoir une communication aisée avec la place Demnat Makhzen de Bab al-Harmun19.
3.1.4. Arborescence dans le tissu ancien de la ville
Le tissu urbain de la médina est rythmé d’arborescence composée de vignes, d’oliviers, et de figuiers. Ces arbres sont plantés surtout aux seuils des portes des maisons, et se développent le long des murs de plusieurs « derb-s » de la médina. Ils animent également les rues et places commerçantes dans la mesure où ils offrent des zones ombragées réduisant les pics de température pendant la saison chaude. Ces plantations, associées aux murs des constructions, peints à la chaux, créent des paysages urbains pittoresques.
3.1.5. Espace verts aménagés aux berges de la source Ras-El-Maa
Les espaces verts aux alentours de la source de Ras-El-Maa se sont peu à peu convertis en un espace appréciable de loisir et de détente. Le quartier environnant, portant le même nom jouit de maints privilèges sur le plan écologique : le versant de la source, les chutes d’eau jaillissant en cascade et les « séguia-s » qui en dévalent, associés aux espaces verts des alentours forment un paysage naturel urbain charmant et attractif.
Jusqu’au début du XXe siècle, la source était le fournisseur d’énergie pour les moulins à eau jonchant ces deux rives. Elle alimentait aussi les champs et les fermes le long de son courant. Actuellement, la source est gérée par l’Office National de l’Eau Potable. Elle est devenue un passage touristique nécessaire pour tous les visiteurs de la ville. Les rives de l’oued et du jardin andalou ont été aménagées pour installer des cafés et des restaurants dont les terrasses permettent de profiter de ce cadre naturel. Ce panorama composite jumelant nature et aménagement urbain est l’endroit touristique le plus fréquenté puisqu’il offre des points de vue surplombant la ville. Paysage urbain et paysage agraire s’entremêlent dans ce quartier périphérique de la ville, où le relief commence à devenir rude, annonçant le commencement de la montagne.

Source : photos de l’auteure, 2017.
3.2. Jardins périurbains ; Paysage naturel périphérique de la ville
3.2.1 Les « j’nan-s »
Les agrosystèmes traditionnellement adoptés dans les montagnes des pays des « jbala-s »ont beaucoup inspiré les jardins urbains et périurbains de la ville de Chefchaouen, dits « j’nan -s». Approvisionnant la ville afin de la rendre auto-suffisante, des jardins potagers et des bosquets ont été établis afin d’alimenter la ville en produits agricoles de première nécessité. En effet, le terme « j’nan », usité communément par les anciennes générations, désigne un verger de forme ancestrale, traditionnelle et typique de la région, de jardins périurbains ou de parcelles agricoles. Celui-ci est souvent composé d’un potager, d'un verger et de végétaux d’ornement sans qu’ils soient séparés. La parcelle forme alors un jardin productif, irrigué par le circuit d'eau, dit « séguia». Ce réseau d’irrigation par gravitation est un système de canalisation qui a été organisé afin d’acheminer l’eau selon une technique de partage assez développée et mise en place depuis la première vague d'Andalous. Il traversait longitudinalement la cité d'Est en Ouest, partant de la source et franchissant le centre, tout en s'adaptant aux courbes de niveau et aux exigences altimétriques20.
La banlieue, qui contourne la ville de l’extérieur, est une « épaisse ceinture de vergers et de jardins »Toutefois, ce paysage naturel riche et abondant ne cesse de muter. En effet, à l’avènement des espagnols, qui ont abattu les mûriers des environs de la médina pour des raisons militaires, au début du XXe siècle, le savoir-faire artisanal de la soie s’est dégradé, ce qui a progressivement mis à terme la plantation des mûriers domestiques, en dépit des efforts des colons espagnols pour relancer cet artisanat avec la plantation de plusieurs mûriers. Ce fait a menacé la ceinture végétale qui entourait la ville en sa périphérie. Les parcelles désignées sont en général de surface réduites, atteignant toutefois les trois hectares aux abords de l’Oued El Kebir où les pratiques agricoles demeurent traditionnelles.
3.2.2. Dimension sociale des jardins périurbains
Le « j’nan », espace planté et agrémenté, est doté d’une certaine dimension sociale qui a perduré jusqu’à la fin du XXe siècle. Il se convertit en espace de récréation et de détente, particulièrement les vendredis, où les familles se reposaient dans un « pique-nique» dit « n’zaha », ou bien à l’occasion de la célébration d’une fête jouissant de ces jardins embellis. Des familles aisées s’y installent aussi pour se détendre, et même pour écouter des musiciens. L’entretien du « j’nan » faisait partie des activités qu’on voulait bien pratiquer en pleine nature. En effet, l’ancrage de la ville dans un environnement à caractère rural a renforcé ces pratiques sociales.
Toutefois, il est certain que s’offrir un « j’nan » n’est pas accessible à toute la société. Ce sont les familles riches qui peuvent s’en acquérir, faisant ainsi de sa possession un signe d’appartenance à la classe sociale aisée. Les « n’zaha-s » ont pratiquement disparu de nos jours et ne représentent qu’une nostalgie dans la mémoire collective de l’ancienne génération. Les jardins périurbains et « j’nan-s » se raréfient car ces espaces ne charment plus les jeunes générations attirées par le milieu citadin et insensibles à toute trace de ruralité..
En définitive, la présence d’espace verts urbains et périurbains, de l’élément eau à fort potentiel et d’une épaisse ceinture de vergers et de jardins en périphérie, associés à un patrimoine urbain et architectural attractif ont contribué à l’éligibilité de Chefchaouen au statut de ville écologique. Néanmoins, ce patrimoine associant culture et nature ne cesse d’être confronté à de divers enjeux et défis nécessitant protection et préservation par des instruments législatifs et des outils réglementaires. Plusieurs acteurs à différents rôles et intérêts collaborent afin d’assurer cette mission.

Source : photos de l’auteure, 2017.